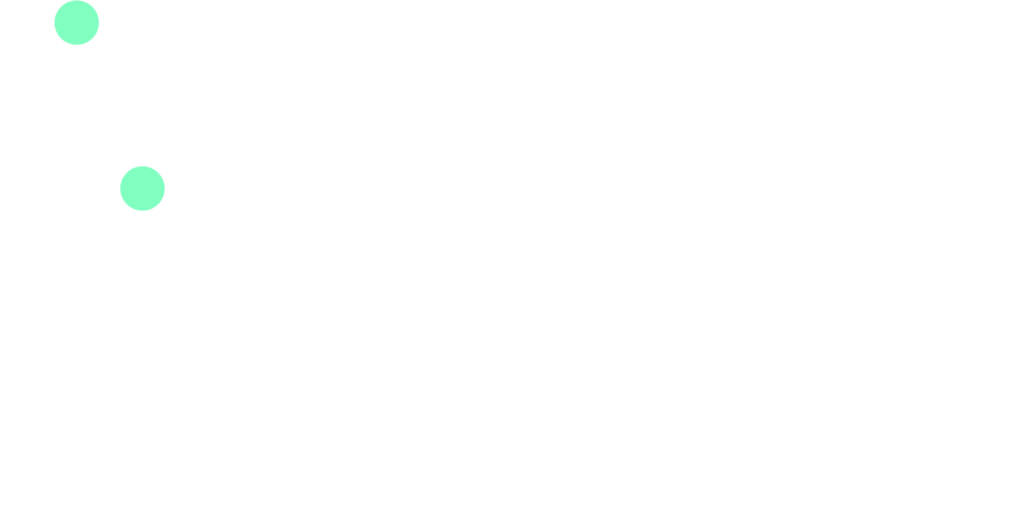Qui a dit que les entreprises n’étaient pas de bonne volonté ? Alors que les membres du CAC 40 n’étaient que 12 % à s’être penchées sur le sens de leur mission en 2009, ils étaient, une loi et trois ans plus tard, près de 80 % à s’être dotés d’une raison d’être. Cette fringale de sens n’aura pas épargné les acteurs économiques de taille plus modeste puisque selon l’Observatoire des sociétés à mission, on compte aujourd’hui plus de 1 200 entreprises ayant poussé la vertu jusqu’à modifier leurs statuts pour y faire une petite place à leur raison d’être. Auxquelles il convient bien évidemment d’ajouter les entreprises de toute taille ayant engagé une réflexion plus ou moins aboutie autour de leur mission sur Terre.
Cet engouement est si soudain qu’il ne va pas sans soulever quelques questions. Notamment quant au sérieux ou, si l’on préfère, la sincérité de la démarche engagée par les comités de direction qui se sont récemment embarqués dans cette aventure. Car on a beau dire et beau faire, la logique économique qui les gouvernaient hier et qui les gouvernent a priori encore aujourd’hui est particulièrement têtue. Au point de balayer sur son passage toute tentative de lui imposer une volonté qui ne serait pas la sienne.
Les déclarations tour à tour lénifiantes ou grandiloquentes qui nous sont souvent proposées en guise de raison d’être — insistant ici sur le “durable”, là sur “l’inclusion” — ont ainsi bien du mal à s’accommoder du réel et sonnent très vite creux dès lors qu’on les met en regard des comportements observés communément dans le monde du travail. Sans parler des scandales ou des pratiques discutables épinglées régulièrement dans les colonnes de nos quotidiens favoris.
Ranjay Gulati, auteur d’un excellent article publié dans la Harvard Business Review, considère, après analyse de plusieurs centaines de raisons d’être, que “la grande majorité [des entreprises] adopte (…) une raison d’être de façade qu’elles mettent en avant tout en agissant de manière superficielle.” On pourrait rajouter “ou contraire aux principes mêmes de ladite raison d’être”. Bref, d’un côté les violons et les sérénades accompagnées de quelques actions concrètes. De l’autre, la dure loi du marché, les pratiques managériales discutables, le lobbying effectué en coulisses et tutti quanti.
L’illusoire promesse de l’indolore
Ranjay va jusqu’à distinguer trois typologies de raisons d’être en décalage avec la dure réalité qui est la nôtre. Les raisons d’être hypocrites communément adoptées par les entreprises qui se retrouvent plus souvent qu’elles ne le souhaiteraient sous le feu des projecteurs et qui n’ont pour objectif que de faire oublier tout un pan d’activités aussi lucratives que discutables.
Les raisons d’être périphériques qui s’attaquent à des sujets de société tout à fait réels mais également tout à fait déconnectés de l’activité de l’entreprise. Confondant RSE et raison d’être, ces entreprises s’emparent d’une grande cause sociétale du moment qui n’a souvent pas grand chose à voir avec ce qu’elles font ou ce qui les fait vivre au quotidien.
Enfin, il y a les raisons d’être présentées comme gagnantes-gagnantes poussées par des dirigeants qui, voulant croire que mission à impact et profits sont deux choses qui vont toujours très bien ensemble, promettent à qui veut bien les écouter de poursuivre les deux de front et de poser par là-même les premières pierres d’un nouvel âge post-capitaliste. Jusqu’à ce qu’ils soient contraints d’admettre que ces deux-là ne font pas toujours si bon ménage et qu’une raison d’être peut induire des arbitrages pouvant pénaliser à court-terme les performances financières de leur entreprise. Une prise de conscience à laquelle la plupart des missions — ou des dirigeants — ne survivent pas bien longtemps.
« La promesse de l’indolore — l’idée que ce qui est bon pour moi le sera pour toi et que ni les investisseurs ni les dirigeants n’ont besoin de se sacrifier pour le bien commun — est terriblement naïve. »
Ranjay Gulati
On peut même soutenir sans grand risque de se tromper que les deux injonctions que sont la rentabilité et la raison d’être de l’entreprise iront par moment dans des directions, sinon contraires, du moins divergentes. Défendre une certaine vision de son métier ou de la société amènera forcément à des renoncements. Ou motivera des choix qui ne caresseront pas toujours les investisseurs dans le sens du poil. À l’inverse, assurer la pérennité de son entreprise, faire en sorte qu’elle reste “dans le game” comme dirait Simon Sinek afin de pouvoir continuer à défendre sa cause année après année, décennie après décennie, nécessitera à n’en pas douter un certain nombre d’incartades par rapport au cap fixé par sa raison d’être.
Tout dirigeant souhaitant donner une vraie chance au WHY de son collectif doit être pleinement conscient de la tension qui peut exister entre raison d’être et profits. Il ou elle doit accepter que ces deux énergies ne peuvent être systématiquement en résonance et que le compromis, dans un sens comme dans l’autre, fait partie inhérente du quotidien de toute entreprise qui se réclame d’une mission inspirante et sincère. Les dirigeants qui parviennent à donner vie à la raison d’être de leur entreprise, nous explique Ranjay, “font preuve d’un idéalisme pragmatique : ils ne se contentent pas d’accepter les compromis, ils s’y plongent corps et âme”.
Un idéalisme pragmatique
On touche là à quelque chose d’essentiel. Si l’idéalisme reste une composante fondamentale de toute raison d’être afin d’inspirer les membres d’un collectif à donner encore et toujours plus de sens à leur action, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle doive planer au-dessus du quotidien. N’en déplaise à certains, une raison d’être n’est pas une notion abstraite condamnée à vivre dans un monde parallèle fait de jolies phrases, de manifestes inspirants et de quelques actions en faveur du bien commun. Un monde immaculé où l’on ne ferait que le bien autour de soi. Un monde que l’on prendrait grand soin de ne pas adultérer en le gardant en marge de la réalité économique et de la basse logique business qui structure notre quotidien. De sorte que chacun puisse suivre son bonhomme de chemin sans se préoccuper outre mesure de l’autre.
Par sa nature-même, la raison d’être est une essentialisation. Essentialisation des valeurs d’une entreprise ou de la vision qui l’anime. Mais pour avoir un sens, c’est-à-dire pour remplir sa fonction première, elle se doit de redescendre rapidement sur Terre pour se mêler aux affaires des êtres en chair et en os qui lui ont donné naissance. Parce qu’une raison d’être est avant tout une raison d’agir, il lui faut se frotter à la matière qui constitue leur quotidien. S’en imprégner en profondeur. De manière à devenir, pour chacun d’entre eux, un outil à même d’éclairer leurs prises de décision, des plus banales aux plus stratégiques.
L'exemple de Gotham Greens

La culture sous serre pratiquée par Gotham Greens permet de réduire substantiellement l’occupation des sols et la quantité d’eau utilisée pour l’irrigation des légumes.
Rentable dès sa première année, l’entreprise est parvenue à lever 130 millions de dollars fin 2020 quelques mois à peine avant d’empocher sa certification B Corp. Elle gère aujourd’hui une douzaine d’exploitations aux États-Unis pour une surface totale de 16 hectares. De quoi réconcilier mission à impact et espèces sonnantes et trébuchantes même pour les plus sceptiques.
Sauf que tout n’est bien évidemment pas rose à Gotham. Il se trouve en effet que les produits vendus par l’entreprise sont conditionnés dans des emballages plastiques à usage unique avec l’impact environnemental que l’on sait. Le PDG de Gotham Greens explique que cette décision qui, de son propre aveu, va à l’encontre de la raison d’être de l’entreprise, n’a été prise ni à la légère ni de gaieté de cœur. Mais qu’après avoir étudié pendant de longs mois toutes les alternatives possibles — de la fibre compostable dans laquelle les légumes flétrissaient bien trop rapidement, au vrac qui aurait fortement réduit l’attractivité des produits auprès de nombreux détaillants américains en passant par le plastique compostable qui s’est avéré beaucoup moins écologique qu’espéré — son entreprise s’était résignée à utiliser du polytéréphtalate d’éthylène (PET), un plastique que savent traiter la plupart des usines de recyclage.
Entre mission et rentabilité, il faut parfois savoir choisir.
Ce “compromis douloureux” nous précise Ranjay était sans doute nécessaire pour garantir le développement de l’entreprise et son impact à terme sur l’agriculture. Si Gotham Greens s’en était tenue mordicus aux principes érigés dans sa raison d’être, elle serait sans doute restée à une taille que le marché aurait considéré comme anecdotique. Ou, pire, elle ne serait peut-être plus des nôtres aujourd’hui. Il ne faut donc jamais perdre de vue que, même pour une entreprise animée par une raison d’être sincère et inspirante, la compétitivité et la capacité à rester rentable demeurent essentielles. Sans elles, il ne peut y avoir de vie sur le long terme et donc de mission qui tienne.
Mais aussi vrai qu’il faut savoir parfois faire passer le profit avant sa raison d’être, une entreprise doit être en capacité de sacrifier sa performance financière au nom de sa mission. Ranjay cite les cas de Livongo, de Recruit (maison mère des sites Indeed et Glassdoor) et de la branche équipement agricole du groupe Mahindra qui ont toutes, à un moment de leur histoire, accepté d’investir significativement à perte et de prendre des risques non négligeables pour rester en phase avec leur raison d’être.
Ni trop idéaliste, ni trop pragmatique, le dirigeant qui ambitionne de donner toutes ses chances à la raison d’être de son entreprise sait que ses décisions ne seront pas toujours gagnantes-gagnantes et qu’il lui faudra naviguer plus souvent qu’il ne le souhaiterait entre ces deux modalités, sacrifiant ici ses principes, là son compte de résultat. En règle générale et sur le long terme, toute entreprise doit chercher à faire cohabiter harmonieusement raison d’être et performance financière. Mais sur le court terme, et ce à plusieurs reprises durant leur histoire, toutes les entreprises sans exception doivent être “prêtes à donner la ‘priorité au profit’ ou à jouer le ‘Bon Samaritain’, pourvu que ces étapes leur permettent de passer à un idéal gagnant-gagnant par la suite”.
Des décisions d’autant plus facilement acceptées qu’elles seront clairement expliquées
L’essentiel dans un cas comme dans l’autre étant de faire preuve de transparence en expliquant clairement en interne comme à l’externe les choix qui ont motivé une décision, surtout si cette dernière a été difficile. À partir du moment où chacun comprend que le sacrifice consenti — soit pour la stabilité financière de l’entreprise, soit pour les valeurs qui l’animent — est à la fois temporaire et pleinement justifié par l’ambition de continuer à servir la mission de l’entreprise sur le long terme, il y a toutes les chances pour que la direction de l’entreprise soit suivie par ses salariés comme par ses autres parties prenantes.
Il va sans dire que cela suppose que votre raison d’être ne soit pas simplement d’ordre cosmétique. Que vous ayez démontré à plusieurs reprises par le passé votre détermination à faire avancer la cause qui anime et fédère votre collectif. Et que, dans l’ensemble, votre pragmatisme n’ait pas la fâcheuse habitude de l’emporter régulièrement sur votre idéalisme. Car comme l’écrit très bien Ranjay, pour emporter l’adhésion de celles et ceux qui vous entourent, “ce qui compte en définitive est la pureté de vos intentions, ainsi que votre ardeur à les poursuivre et à les incarner”.